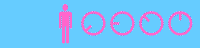
Table des matières

Une réaction de Michel Chion
J'ai été assez étonné par l'article de Régis Renouard Larivière, et puisque la rédaction
d'Ars Sonora
m'a invité à lui donner ma réaction, je le fais bien volontiers : qu'on ne voit pas dans les quelques lignes qui suivent un désir de polémiquer, simplement
celui de rétablir ce que je pense être équitable sur un auteur et un penseur à l' uvre
duquel j'ai consacré beaucoup de temps (notamment pour écrire le Guide des Objets Sonores
) et qu'il est plus courant de voir attaqué et critiqué que prolongé et défendu.
L'article veut souligner des lacunes ponctuelles, mais de touche en touche, je me
demande ce qui reste de valable dans le Traité
aux yeux de Renouard Larivière. " De l'objet sonore en soi, nous n'en saurons [avec le Traité] pas davantage ", écrit-il par exemple... Je ne sais ce qu'il appelle "en soi" (c'est peut-être là
toute la question), mais en tout cas, il faut redire que le Traité
consacre une très large partie de ses 670 pages et son plus grand tableau récapitulatif
à l'objet sonore, justement, à la classification typologique des objets, à leur
description morphologique, à leur différenciation en genres, espèces, etc..., et
enfin à une réflexion sur leur potentialité musicale, par l'hypothèse du triple champ
perceptif. Je ne peux donc comprendre comment l'auteur peut dire que " la réponse de Schaeffer [à ce qu'on entend dans l'objet réduit] est une temporisation ". Schaeffer y répond tout à fait largement, en désignant les limites mêmes de son
domaine, et surtout -- c'est là un point capital que j'aurai l'occasion de développer
dans un livre que je prépare sur Schaeffer pour une collection dirigée par Bruno
Giner -- en structurant les limites même du champ qu'il définit, ce qui permet de les élargir
(je veux dire par là que les critères au nom desquels il repousse du champ musical
certains objets sont eux-mêmes très bien définis, et donc donnent des clefs pour
décrire et appréhender ces objets mêmes).
Lorsque Régis écrit : " Il y a un (...) mode de perception du son dont ne parle pas Schaeffer, c'est la peur ", je comprends mal également ce genre d'argument, applicable à n'importe quel travail,
le plus immense fût-il, sur n'importe quel domaine. A ce compte, il est facile à
quiconque de démolir en une phrase l' uvre de Freud ou de Marx, en partant de ce
dont ils ne "parlent pas". Dans ce cas, la peur et d'une manière générale tous les affects
liés, pour des raisons intrinsèques ou extrinsèques, au son et à son écoute, ne rentrent
pas dans le champ dont Schaeffer s'occupe et qu'il a clairement défini dès le départ. Simplement, la recherche et la formalisation de Schaeffer permettent de beaucoup
mieux théoriser les affects en question, et de réfléchir pour savoir s'ils proviennent
des sons eux-mêmes ou des projections que l'on fait sur eux, que tout un livre sur
Le son et la peur
, où l'on ne préciserait pas au départ ce qu'on entend par "le son". Dans mes cinq
livres sur le son au cinéma, où je m'occupe justement des sons en situation narrative,
c'est la formalisation schaefférienne qui me permet de m'occuper des significations
et des effets, en les situant à leur juste niveau.
L'auteur s'est-il bien rendu compte du caractère quelque peu présomptueux de certaines
de ses critiques ? Renouard Larivière écrit ainsi qu'il y aurait dans le Traité
des "confusions" (entre élémentaire et causal), mais par causal, dit-il plus loin,
il faut entendre une allusion aux "causes" de musique (aux potentialités?) que contiendrait
l'objet sonore. Ici, il y a doute sur l'emploi du mot "causal", et souvent, l'auteur surfe ainsi sur une sorte d'ambiguïté qu'il crée lui-même dans la façon dont il pose les mots.
Dans son analyse de la relation objet/structure telle que Schaeffer l'énonce, Renouard
Larivière croit voir une contradiction (au sens logique), ou plutôt un "basculement"
dans un autre niveau, alors qu'il s'agit, comme avec beaucoup d'autres couples de
notions schaeffériens (identification/qualification), d'une dialectique perceptive.
L'objet ne "disparaît" pas dans la structure, il existe par elle comme étant lui-même
structure de critères. Certes, il y a de quoi discuter dans cette proposition, et
il me semble que Delalande a émis là-dessus des critiques assez pointues (Pertinence et Analyse Perceptive
, in Cahiers Recherche/Musique
n 2), mais on ne peut pas la réduire à une sorte de contradiction interne handicapant
toute la démarche.
Je ne suis pas d'accord, par ailleurs, avec le principe consistant à se réclamer d'une
citation isolée d'un auteur pour appuyer la critique qu'on fait de lui sur l'ensemble
de son travail -- ce type de sophisme qu'il y a à écrire : " Schaeffer lui-même n'écrit-il pas, etc ?... " Bien sûr, il l'écrit, mais c'est lui qui l'écrit et pas dans le même contexte ni
dans le même but que celui qui déniche ce prétendu "aveu" -- et la part de propositions
positives et d'ouvertures théoriques que contient le Traité
est écrasante, par rapport aux quelques légitimes et compréhensibles doutes exprimés
par son auteur. De même, quand Régis joue sur le sens du mot "réduction" (employé
par Schaeffer dans le sens strict de réduction phénoménologique) et sur les connotations
péjoratives que possède ce mot en français pour suggérer que, finalement, " Schaeffer lui-même... ". On ne peut pas retourner quelqu'un contre lui-même, surtout sur de telles bases.
C'est une façon de se dérober à la responsabilité de se situer soi-même dans sa propre
position à l'égard de cette personne, et de dire "je" quand on le critique.
Je constate au passage que c'est un type de discours qui a été beaucoup tenu sur Schaeffer.
Pour le diminuer, on n'a retenu de ce qu'il disait que ce qui pouvait alimenter cette
image réductrice. Ainsi, une journaliste du Monde
titrait-elle son "hommage" à Schaeffer, lors de sa disparition en 1995, " Ni chercheur, ni compositeur, ni écrivain " (rien moins !) et l'on comprenait en lisant l'article qu'il était arrivé à Schaeffer de dire ou
d'écrire ça, et que donc si Schaeffer lui-même l'avait dit, cette dame pouvait le
reprendre comme titre, sans avoir à signer cette phrase et en à assumer l'énormité.
Que voulait-on de Schaeffer ? Qu'il soit inébranlable comme un roc, ait l'arrogance de ceux qui ne doutent jamais -- qu'il soit un peu imbécile, en somme ? En tout cas, je peux témoigner qu'il a toujours tenu non seulement à ses doutes
mais aussi à ses idées, et qu'il a réaffirmé celles-ci à chaque occasion, notamment
à celle de la réédition du Traité,
ainsi que dans des émissions que Christian Zanési et moi lui avons consacrées en
1984 (Les Jeux du Sonore et du Musical
).
" L'illusion de Schaeffer, dit aussi Régis Renouard Larivière, est de croire que la
musique puisse être déterminée à partir d'elle-même ". En quoi s'agit-il d'une "croyance", et comment l'auteur a-il démontré que Schaeffer
y croit ? Et si c'est une "illusion", par rapport à quelle vérité que l'auteur nous démontre
comment ? Ce qui est clair dans le Traité
, c'est la postulation que les lois du musical sont partiellement naturelles, c'est-à-dire
partiellement fondées sur les propriétés de l'écoute. En quoi d'ailleurs, Schaeffer
ne fait que dire (ou redire) une évidence, mais cette évidence devait être réaffirmée et refondée, surtout dans le contexte des années 60 -- que Renouard Larivière
n'a pas connu (et je ne le lui reproche pas, mais il peut trouver facilement des
informations sur cette décennie, riche en publications). Le dit contexte musical,
en Europe, était en effet aveuglément "culturaliste" ; en d'autres termes, beaucoup (comme Xenakis, Boulez, Stockhausen, qui depuis ont
nuancé leur position) étaient alors convaincus que tout système musical, le plus
arbitraire et le plus conçu in abstracto
fût-il, pouvait s'apprendre et s'imposer par l'usage, et l'on se préoccupait donc
peu de la "perceptibilité" des structures écrites sur la partition et du fonctionnement
de l'oreille.
Enfin, des phrases comme " Schaeffer ne fait pas confiance à la perception " ne peuvent évidemment pas être réfutées. Que sait-on de la "confiance" de Schaeffer ? S'agit-il d'un verdict fondé sur un examen minutieux de l'analyse perceptive de
Schaeffer ? Cette affirmation, si catégorique, devrait à ce moment-là s'accompagner d'un argumentation.
S'agit-il plutôt d'une pétition de principe, d'une intrusion dans la psychologie
du sujet Pierre Schaeffer ? On ne peut rien en savoir.
" Schaeffer croit, Schaeffer s'illusionne, Schaeffer cherche à sauter par-dessus son
ombre, Schaeffer ne fait pas confiance ", dit Régis Renouard Larivière. Nous sommes, quand nous lisons ce genre de choses,
et faute que l'auteur appuie ses dires par un nombre suffisant de citations et par
une véritable démonstration, dans une zone floue entre le verdict théorique et le
procès d'intention psychologisant. C'est le genre d'affirmations que l'on peut avancer au
terme d'un essai de 150 pages -- mais dans un contexte si bref, cela peut difficilement
aller au-delà de la boutade.
Je suis très frappé aussi par la vision toute idéaliste et comme pré-structuraliste
que Régis semble se faire du langage, lorsqu'il écrit une phrase comme " lorsqu'on prononce le mot arbre
, cela nous met en rapport immédiat et sans doute possible avec le végétal ligneux. " Je voudrais bien savoir sous quelle forme existe ce "nous" qui est ainsi mis en
rapport, et en quoi consiste ce "rapport" quasiment magique que le mot créerait avec
la chose, et enfin ce que recouvre ce singulier générique : "le" végétal. Pour le structuralo-marxo-lacanien que je suis (je fais allusion ici,
non à mes croyances, mais à mes références), l'arbre, surtout au singulier, est
bien évidemment une notion culturelle et symbolique, un fait de langage, d'où l'apparence d'un "rapport immédiat". Si j'insiste là-dessus, c'est parce que Schaeffer, sans
être lacanien ou structuraliste, pense lui-même à partir du langage.
Dans le même ordre de choses, c'est une grande naïveté que d'écrire que le niveau
poétique, dans la langue, est le correspondant exact du niveau musical. Tout le problème
est là, justement : le signifié, et pas seulement le signifiant phonique ou verbal, joue un rôle étroit
dans la poésie, sans quoi il n'y aurait aucune différence entre poésie lettriste
et poésie au sens traditionnel. Ce qui caractérise la poésie traditionnelle (en
dehors du "vers libre"), qu'elle soit japonaise, française, ou allemande, c'est que par des
conventions métriques et phoniques (rime, allitérations, assonances...) conventions
pouvant être dites, si l'on veut, "musicales", elle fait miroiter le raport signifiant/signifié d'une façon spécifique. Pour autant, elle ne "surmonte" ou "n'ignore" aucunement
le niveau du signifié, du dénoté, et elle accuse, plutôt qu'elle supprime ou transcende,
la barre entre signifiant et signifié. Dans la musique, en revanche, il est bien malaisé de dire comment l'on peut trancher entre l'un et l'autre, et Schaeffer
éclaire de manière assez riche ce problème. Régis peut écrire par ailleurs : " de poésie, ni Saussure, ni Schaeffer ne s'occupent ", -- reste que ce que le premier a commencé à formaliser a permis de penser, voire
de pratiquer autrement la poésie et plus généralement la littérature, et que ce
que le second a proposé pourrait pemettre de comprendre, voire de pratiquer autrement
la musique.
Renouard Larivière termine en évoquant, comme un recours, la figure idéalisée du
compositeur, au singulier -- le compositeur qui répondrait à l'appel de l'objet. Moi,
je ne connais pas le
compositeur, j'en connais plusieurs de sensibilités et de pratiques bien différentes,
et je constate qu'ils peuvent être menés par des appels également tout différents.
Certains d'entre eux, c'est clair (sans être pour autant de "mauvais" compositeurs)
sont d'ailleurs intéressés par tout autre chose que le son.
Ce que je crains, c'est que cela, ne soit finalement compris comme une revendication
obscurantiste, sur le mode "pourquoi réfléchir, penser sur la musique et travailler
à nommer les sons, contentons-nous de composer..." Oui, mais alors, pourquoi revenir
sur Schaeffer ?
(14 mars 1997)
