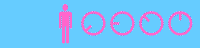
Les identifications aléatoires
Nous vivons manifestement, sinon une crise radicale, du moins un très fort
déplacement des identités collectives. Nous vivons une remise en question de
ce que nous sommes. Cela s'est fait, au fond, assez vite: depuis une dizaine
d'années, ce ne sont pas seulement les statuts sociaux, les identifications
culturelles, les représentations individuelles qui subissent des mutations
décisives ‹ mais aussi les grands récits organisateurs de l'avenir qui
s'affaissent brutalement: impasse des idéologies de la modernité sous leur
aspect bourgeois; déconfiture des idéologies de l'émancipation (marxisme
institutionnel, socialisme assistanciel, socialisme réellement existant) ‹
retour brusque de l'individualisme farouchement concurrentiel (libéralisme
carnassier et inégalitaire), déferlement des thérapies collectives radicales
(fondamentalisme religieux). Régression, pour le dire avec les mots de Emile
Durkheim, des solidarités mécaniques vers les solidarités organiques. Déplacement
donc des statuts, dissipation des représentations de l'avenir. Nous vivons chacun
pour soi et notre avenir est la nostalgie de notre passé. Opacité du futur,
déficience de l'espoir.
Pourtant la vérité est que, écrit Claude Lévi-Strauss, réduite à ses aspects
subjectifs, une crise d'identité n'offre pas d'intérêt intrinsèque. Cette
affirmation qui paraît à première vue choquante, présente cependant un profond
contenu de vérité. Car les représentations, les catégories mentales, la structure
des volitions réduites à leurs dimensions subjectives et strictement individuelles
sont très relatives et souvent non significatives. Autrement plus intéressante, en
revanche apparaît la crise qui touche les fondements profonds sur lesquels reposent
ces représentations, ces catégories, ces volitions. Car ce sont alors les structures
des identités collectives qui sont affectées et, par suite, les mécanismes mêmes de
la cohésion sociale qui sont déstructurés.
Une crise d'identité individuelle peut être passible de diverses lectures:
pathologique (sous l'espèce de la psychopathologie clinique), psychanalytique (par
le biais de l'introspection freudienne), antipsychiatrique (par l'analyse critique
des mécanismes de coercitions institués: famille, école, hôpitaux, etc.) ou parfois,
encore, directement normative (voir la manière dont le comportement délinquant est
saisi par la justice). Ce pluralisme méthodologique repose sur un postulat explicite
et terriblement opératoire: le postulat de la cure. Le système des normes, des
valeurs, ainsi que le mécanisme de leur articulation propre, étant structurellement
stable, il ne reste plus qu'à réintroduire dans cette universalité normative et
consciente d'elle-même les particularités individuelles en déréliction. La cure a
précisément cette fonction. Et elle implique l'existence d'un curateur ‹ c'est-à-dire,
au fond, d'une référence originelle, et pour certains d'une source de lumière à
revivifier.
Rien de tel dans les crises d'identité collectives: là, ce quii s'estompe, c'est en
vérité le postulat, le sol stable sur lequel repose le vaste édifice des
représentations admises et de l'entremêlement collectif. La cure existe bien, ici
aussi, mais elle est souvent sauvage et d'intensité plus ou moins dramatique selon
le degré de délitescence des solidarités de groupe: des apprentis sorciers peuvent
alors se lever, quii entraînent dans leur délire des sociétés entières. Ce qui est
cependant significatif de ces crises d'identité collectives, c'est qu'elles
fonctionnent principalement à l'exclusion, et parfois à l'annihilation.
Il serait bien sûr trop facile de croire à une nette séparation entre ces deux
formes de crise. Et si l'on a bien saisi le sens de la proposition de Claude
Lévi-Strauss, il est nécessaire de tenter de repérer ce qui, dans la crise de
l'individualité, participe d'un remaniement des structures profondes et des
références identitaires collectives.
Le déplacement des identités collectives affleure d'abord à la surface de notre
temps comme une réaffirmation exacerbée des identités spécifiques. Dans sa
signification, cette réaffirmation est réactionnelle; dans son contenu, elle
implique un comportement collectif logique bien que paradoxal: il est impérial
et protectionniste. Impérial, car pour ne pas dépareiller l'identité menacée,
ce comportement vise à rendre semblable, à pourchasser la différence, protectionniste,
car cette quête de l'identique à soi est en vérité une forme spécifique de
confirmation de la différence. Mouvement non dialectique par excellence, qui vise
donc à hypostasier la particularité du soi menacé en universalité, en référence
dominante. Mouvement en somme de réaffirmation de la domination. Ce mécanisme agit
tout autour de soi: face à l'étranger, face au sexe différent, face au chômeur, face
au jeune, face à tout ce qui implique un possible remaniement du soi. La crise des
grands récits unificateurs, crise non des représentations transcendantales (la
religion, le mysticisme), mais bien celle des conceptions laïques, rationalisatrices,
temporelles, ‹ la crise en comme de la réussite humaine collective ici-bas a libéré
non pas le désespoir , non pas le pessimisme, non pas le renoncement, mais bien comme
l'avait déjà perçu Max Weber au début de ce siècle, le désenchantement du monde, la
réduction du monde des valeurs au système des moyens en vue d'une fin particulière
(Zweckrationalität), le retour répétitif des individualismes anté et anticollectifs:
valorisation de l'égoïsme, exacerbation de la xénophobie, du racisme, de
l'ethnocentrisme.
Ce retour de l'individualisme carapaçonné est significatif: il présuppose en vérité
un très profond décentrement de l'individualité elle-même. C'est parce que celle-ci,
l'individualité moderne, ne se reconnaît plus dans la collectivité qu'elle débouche
sur l'individualisme. En soi, l'individualisme comme représentation du monde n'est
pas passible d'un jugement abstrait de valeur: il n'est ni bon, ni mauvais; il est ,
sans plus. Il correspond à une possibilité consubstantielle de l'espèce, enracinée
dans la formation historico-sociale de l'individualité. Déjà Kant avait mis en
évidence le dualisme qui commande ce processus: c'est le caractère, dit-il,
d'"insociable sociabilité" de l'homme qui est le noeud fondateur de l'ordre humain.
Le passage à la communauté, le dépassement de l'individualisme instinctif vers
l'individualité raisonnable, non immédiatement instinctuelle, procède des contenus
et des formes de socialisation soit données soit à constituer.
L'individualité débouchant sur l'individualisme instinctuel est, dans l'esprit de
Kant, une manière de régression, une sorte de réduction inadmissible de l'individu
à son soi, une rupture en somme du contrat de société. Voilà pourquoi Kant a besoin,
pour fonder sa conception de la sociabilité, pour opérer le passage du particulier à
l'universel, de l'individu à la communauté, voilà pourquoi il a besoin de la morale
et de la table des impératifs catégoriques. Voilà pouquoi, en somme, il a besoin de
ce qu'il nomme lui-même la légalité universelle , et de la définition de ses contenus
dans la Doctrine du droit et dans la Doctrine de la vertu. Toute cette métaphysique
des moeurs repose cependant sur la contrainte, donc sur une vision radicalement
affirmative de l'ordre social. La loi y est la Norme, et celle-ci est impérative.
Le théoricien du normativisme juridique comme fondement de l'ordre social, Kelsen,
avait donc raison de clamer sa filiation à Kant. Mais c'est là une stratégie
artificielle: les normes ne tiennent que si les valeurs qui les sous-tendent sont
stables. Or le décentrement contemporain de l'individualité, sa fuite vers
l'individualisme, exprime peut-être une destabilisation des valeurs fondatrices de
la civilisation bourgeoise et capitaliste dans une époque où les valeurs temporelles
alternatives (surtout socialisme réellement existant) n'apparaissent plus comme
réellement alternatives et praticables. D'où le flottement de l'individualité,
la polysémie de ses comportements, le caractère entropique de son parcours.
La condition postmoderne est une aventure imprévisible, la condition identitaire
contemporaine est aléatoire.
On pourrait à partir de là envisager une série de problèmes. Tenter par exemple de
réfléchir sur les raisons historico-sociales qui rendent possible ce décentrement
de l'individualité. L'analyse de la répartition des richesses, la structure de
l'organisation des rapports de production, la formation des modes de domination,
les stratégies d'exploitation, l'articulation des rapports de force, les mécanismes
de légitimation et les formes de délégitimation, les objectivations enfin de
l'ordre social (les idéologies, les cultures, les institutions etc.) ‹ chacune de
ces sphères permettrait de voir à l'oeuvre ce décentrement. Et chacune porterait
sans doute une explication.
On peut aussi se limiter à une approche plus réductrice en repérant la caractéristique
centrale de cette crise par ailleurs à l'oeuvre dans toutes les sphères du social:
c'est ainsi que le décentrement de l'individualité apparaît, au-delà de la variété de
ses figures, comme déployé sur le fond propre de la cohésion sociale: le parcours va
ici de la destructuration des groupes, de la redistribution des rôles, de la permutation
des fonctions assignées, à la mutation des formes de l'individualité. Délitement des
groupes sociaux, destabilisation de la cohésion interobjective et subjective,
reformulation du lien social. Façon classique, en somme, de reconsidérer un vieux
problème de sens commun: qu'en est-il des rapports de l'individualité et de la communauté
dans une situation de crise des solidarités collectives ? De Emile Durkheim à Talcott Parsons,
les grandes réponses, on le sait, ne manquent pas.
Deux perspectives doivent cependant être relevées ici. Dans la première, il est clair que
la crise implique un redéploiement du rapport des normes et des valeurs: ces dernières,
en tant qu'elles sont fondatrices de l'identité socio-culturelle des groupes, deviennent
inadéquates par rapport au système dominant des normes. Envisageons par exemple le problème
de l'égalité: on peut voir jouer aujourd'hui cette inadéquation d'abord sur le plan de
l'affirmation normative de l'égalité des droits, laquelle est, sur le fond, directement
démentie par l'inégalité originelle de condition sociale ‹ mais ce premier aspect des choses
est d'une certaine façon occulté et subsumé sous l'égalité formelle de la loi. La philosophie
profonde de ce mécanisme peut se définir à peu près comme suit: la condition sociale dépend de
l'individu et de sa puissance d'objectivation par rapport à d'autres individus tandis que la
dimension publique de l'individu est déterminée par le principe de l'égalité devant la loi.
Egaux devant la loi, les individus sont chacun pour soi dans la société. Autrement dit,
la norme égalitaire est sous-tendue par le principe de la valorisation individuelle,
virtuellement inégalitaire; l'écart entre la position normative et la position valorielle
est ici structurel et inapparent.
Disons-le autrement: la norme égalitaire masque la réalité inégalitaire. Ensuite, sur le
plan de la compétition sociale: celle-ci est devenue, dans l'actuelle situation de crise
tellement exacerbée que le principe d'égalité devant la loi s'en trouve lui-même affecté;
les valeurs liées à l'affirmation de soi dans l'ordre social (égoïsme, individualisme
aversif, concurrence économiquco-sociale) prennent le pas sur les normes d'égalité et
de justice telles qu'elles sont objectivées dans la loi: ce sont alors celles-ci qui
changent: on le voit à l'oeil nu aujourd'hui dans le statut octroyé à l'étranger, à
l'immigré, au chômeur en "fin de droits", aux femmes et aux jeunes. Cela signifie d'abord
et surtout une réadaptation de la norme formellement égalitaire aux valeurs structurellement
inégalitaires propres à l'ordre social contemporain.
La deuxième perspective tient au statut de la diversité dans la communauté. On l'a dit:
la crise des identités collectives fonctionne principalement à l'exclusion; la diversité
y est perçue comme une menace, elle devient intolérable parce qu'incommunicable. Il est
intéressant de voir comment cette bipolarité de l'inclusion-exclusion est tout à la fois
épistémologiquement critiqué, mais normativement légitimée par un auteur aussi solide que
Claude Lévi-Strauss. Dans l'avant-propos du séminaire sur l'Identité, il écrit: "Ceux qui
prétendent que l'expérience de l'autre individuel ou collectif est par essence
incommunicable et qu'il est à jamais impossible, coupable même, de vouloir élaborer un
langage dans lequel les expériences humaines les plus éloignées dans le temps et dans
l'espace deviendraient, au moins pour partie, mutuellement intelligibles, ceux-là ne
font rien d'autre que se réfugier dans un nouvel obscurantisme." Dans le Regard éloigné,
il soutient en revanche qu'"il n'est nullement coupable de placer une manière de vivre
et de penser au-dessus de toutes les autres, et d'éprouver peu d'attirance envers tel
ou tel dont le genre de vie, respectable en lui-même, s'éloigne par trop de celui auquel
on est traditionnellement attaché. Cette incommunicabilité relative n'autorise certes pas
à opprimer ou détruire les valeurs qu'on rejette ou leurs représentants, mais maintenue
dans ces limites, elle n'a rien de révoltant. Elle peut même représenter le prix à payer
pour que les systèmes de valeurs de chaque famille spirituelle ou de chaque communauté
se conservent, et trouvent dans leur propre fonds les ressources nécessaires à leur
renouvellement. Si, comme je l'écrivais dans Race et Histoire , il existe entre les
sociétés humaines un certain optimum de diversité au-delà duquel elles ne sauraient aller,
mais en dessous duquel elles ne peuvent non plus descendre sans danger, on doit reconnaître
que cette diversité résulte pour une grande part du désir de chaque culture de s'opposer à
celles qui l'environnent, de se distinguer d'elles, en un mot d'être soi; elles ne s'ignorent
pas, s'empruntent à l'occasion, mais pour ne pas périr, il faut que sous d'autres rapports,
persiste entre elles une certaine imperméabilité."
Ces deux positions ne sont pas contradictoires; on constate néanmoins que la seconde, non
seulement atténue, mais réduit brutalement la première à une pétition de principe.
Lévi-Strauss affirme certes que la communicabilité est relative, et qu'il suffit de
vouloir pour pouvoir dresser des passerelles entre des cultures diverses. Cependant,
en affirmant l'existence d'un noyau culturel irréductible au groupe et incommunicable,
il rend légitime une sorte de différence ontologique entre les humains que rien dans
la pratique, surtout dans la société moderne, ne justifie. Qui, d'autre part, définit
le seuil "en dessous ou au delà" duquel une société ne doit pas aller ?
Or force est de constater que ces questions ne peuvent recevoir de réponse métaphysique
ou de sens commun; elles ressortissent plutôt à la logique des rapports de force réels
dans la société, et des positions qui y sont occuppées par tel ou tel groupe social.
De façon radicale encore, qu'est-ce que le contenu du concept de seuil lui-même ? Se
porte-t-il aux normes, aux valeurs, ou aux deux à la foix ? Dans tous les cas de figure,
l'accord sur le contenu du concept de seuil est indécidable puisque, excepté la situation
d'agression violente, chaque groupe social, à peu près comme chaque individu, aura
tendance à réagir différemment face à l'altérité humaine et culturelle. Il est en
revanche manifeste que, dans des situations de crises sociales exacerbées, le rapport
à la diversité devient plus problématique et des traits culturels ou ethniques distincts
peuvent apparaître comme des points de fixation et de confrontation entre groupes et
individus. Mais cela relève moins de critères objectifs d'opposition que d'une mobilisation,
fortement fantasmatique, de l'imaginaire collectif de l'indigène par rapport à ce qui est
perçu comme allogène. De là toute une série d'attitudes injonctives: injonctions
d'assimilation, réaction différentialiste, et ainsi de suite ‹ tant il est vrai, pour
reprendre l'expression de Theodor Adorno, que "la violence du rendre semblable reproduit
la contradiction qu'elle élimine".
Crise de l'individualité, déplacement du rapport des normes et des valeurs, ambiguité de
la diversité, inconfort de la différence: autant de signes favorisant l'émergence des
identifications aléatoires. Il n'y a pas de panacée pour résoudre les redoutables problèmes
inhérents à cette situation. Il n'y a au fond que deux attitudes réellement porteuses de sens.
L'une consiste à se replier sur les références originaires, à s'opposer à l'ambiguité et à
la labilité des identifications, à fixer en somme dans des cadres mentaux et conceptuels
précis l'identité personnelle, sociale, nationale, culturelle et religieuse ‹ attitude
dont Hegel a très lucidement mis en évidence l'équation tautologique dans la formule du
Ich bin Ich ‹ je suis je‹, et qui rencontre, semble-t-il, aujourd'hui la faveur d'une
grande partie de l'opinion française et l'assentiment d'intellectuels de renom. L'autre
attitude en revanche retourne sur elle-même la crise de l'identité: et si, au fond,
l'émergence des identifications aléatoires, changeantes, mutantes, était une bonne chose ?
Pourquoi devrait on concevoir à priori comme dangereuse la nouveauté, l'originalité,
la singularité ? Dans la crainte de l'Autre, c'est la position dogmatique et adversive
du Je qui transpraît. La question réelle n'est pas d'accepter ou de refuser l'avènement
de nouvelles identités; celles-ci apparaissent et sont de toute façon irréductibles,
incontournables. La question est de savoir comment éviter socialement et culturellement
de les soumettres à l'universalité abstraite ou de les réduire à des particularités
folkloriques. Autrement dit, il importe de se demander quel peut être aujourd'hui le
statut non de l'universalité (celle-ci est en crise, c'est une abstraction métaphysique),
non de la particularité (celle-ci est narcissique et souvent bêtement réactionnelle),
mais bien de la singularité. Comment peut-on être arabe en France, noir ou tout
simplement de "souche" non européenne, ‹ comment ces singularités peuvent-elles se négocier,
se transformer, devenir des aspects culturels et humains intériorisés et assumés par
la société française ?
La tradition française dominante en ce qui concerne les valeurs est sur ce plan très
inquiétante; si l'on prend le cas du rapport au monde arabe et africain, l'attitude
qui a historiquement prévalu est celle de l'exclusion: celle-ci était précisément
rendue possible par le fait que les Mahgrebins comme les Africains étaient territorialisés
dans leurs pays d'origine, donc situés en dehors de l'Hexagone. Le colonialisme français
n'était assimilationniste que sur le plan idéologique; dans les faits il était une forme
d'apartheid: en Algérie même, par exemple, la population européenne colonisatrice était
séparée (par la loi, par les droits, par le savoir et par le pouvoir) de la population
juive jusqu'au décret Crémieux (1870) et de la population musulmane jusqu'à la fin de
la Seconde guerre mondiale. C'est cette séparation même qui détruisit ce qu'elle
prétendait préserver, à savoir le système colonial. Vis-à-vis du juif, en France, ou
même du Polonais ou de l'Italien, le problème était différent, car l'intrus vivait au
coeur du pays: la stratégie d'assimilation joua pleinement. La singularité du Juif, du
Polonais ou de l'Italien n'a pu se maintenir ici que sur le fil étroit du repli commautaire.
Même si l'exemple du judaïsme français prouve de façon éclatante que le statut de minorité
peut se concilier avec une grande ouverture, rien ne permet de penser que le repli auquel
sont acculées des communautés soit par ailleurs le meilleur garant de la singularité; tout
démontre au contraire que, repliées sur elles-mêmes, les communautés risquent de se figer
et de perdre le sens de l'ouverture aux autres. On retrouve aujourd'hui ce problème à
propos des populations immigrées: pourront-elles s'intégrer sans se renier ? L'identité
culturelle française, aujourd'hui en crise, permettra-t-elle l'expression de cette
singularité, ou au contraire, par son refus, rendra-t-elle inévitable l'émergence d'un
sentiment communautaire stigmatisé, affligé, recroquevillé enfin dans le repli et le
culte de la spécificité ? Va-t-on vers un renforcement de la différence adversive, vers
une sorte de solidification d'un individualisme communautaire ou permettra-t-on plutôt
l'intégration libre de l'individualité singulière dans le système des valeurs et des
normes actuellement en tranformation ? Car ces populations sont incontestablement
aujourd'hui en situation de mutation; leurs identités sont incertaines, leurs
identifications tout aussi aléatoires.
Que signifie par exemple être "beur" en France aujourd'hui ? Est-ce une identité ?
Est-ce une identification ? Est-ce un avenir ? Etre "beur", c'est être objectivé
dans une représentation donnée: c'est avoir une généalogie arabe dont le statut
est déprécié en France, mais c'est également être suspect aux yeux du monde arabe
parce que trop occidentalisé. Etre "beur", c'est donc être entre-deux et c'est,
par la force des choses, se choisir dans le présent, à défaut de choisir entre
ces monstres froids que sont les appartenances collectives. C'est attendre, attendre
que "ça change". Espérer, consciemment ou inconsciemment que les déplacements
d'identité en cours achèvent leur mouvement, réalisent leur révolution peut-être.
Et vivre une vie incertaine, subir une identification sans concept, assumer une
désignation objective sans renier ce qui la rend possible (la généalogie arabo-berbère)
mais sans la survaloriser non plus.
On pourrait montrer d'autres mécanismes à l'oeuvre, pour fournir une idée plus concrète
de ces procès d'identifications aléatoires dans une situation de crise d'identité
collective: ainsi en est-il des modifications de l'identité collective; ainsi en
est-il des modifications de l'identité sexuelle, des mutations de l'identité
professionnelle, des tranformations de l'identité morale, etc. Tous ces processus
sont certes relatifs, et ils ne peuvent en aucune manière apparaître comme une
structure identitaire nouvelle: ils sont des passages, des voies d'accès vers
autre chose. Mais, libérés, ils peuvent fournir , sinon l'image précise de ce
que sera la société de demain, du moins l'air ‹ l'air vital‹ que veulent respirer,
simplement pour vivre, tous ceux sur qui la grâce d'une vie tranquille ne s'est
pas posée.
* Professeur de Sciences politiques à l'Université de Paris VIII.